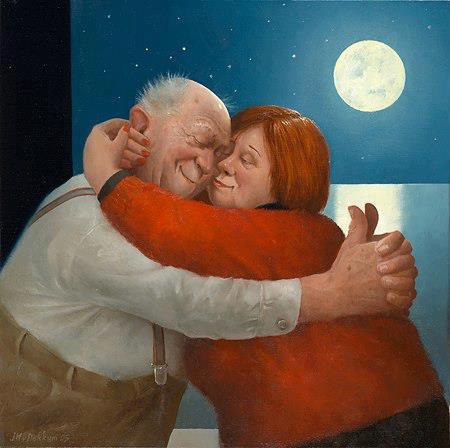
De la Friction au Massage, l'histoire
d'un roi et de son Dauphin.
Par
Alain
Cabello-Mosnier.
P/O le CFDRM
Libre de droits non commerciaux.
Rédigé
à Paris le : jeudi 11 avril 2013
De la Friction au Massage, l'histoire
d'un roi et de son Dauphin.
Le
mot friction
vient du lat. imp. frictio, terme
de médecine lui-même formé
sur le supin frictum de fricare « frotter
» a ainsi régné sans partage pendant
plus de deux milles ans en partance de ses sources latines
jusqu'à la formation française du mot
friction. Il fut quasiment
le seul mot alors disponible pour qualifier le massage
et il nous faudra attendre le XIXe pour que le vocable-Dauphin
sorte des forges conjuguées des linguistes et
des voyageurs et que le massage supplante définitivement la friction.
Comme c'est souvent le cas lorsqu'on étudie les
mots, nous y trouvons bien des informations sur notre
histoire et par-delà, sur ce que nous sommes,
c'est par le mot que la psychanalyse
de l'histoire révèle ses blessures les
plus profondes et ici, la nature-même des liens
que cet occident a pu entretenir avec son corps.
Un corps résolument abordé par la friction
est un corps que l'on malmène, notez simplement
le préfixe fri, qui à lui-seul, évoque
la résistance, frigidus, frais,
froid, glacé  que la friction se propose de réchauffer
en limant le papier de verre d'un
frisson sur la peau. Ce joli malaise corporel
que l'on soigne par le frottement de la peau par l'énergie du mouvement parait
bien dans ce mot, plus rigide, contrôlé
que dans celui de massage.
que la friction se propose de réchauffer
en limant le papier de verre d'un
frisson sur la peau. Ce joli malaise corporel
que l'on soigne par le frottement de la peau par l'énergie du mouvement parait
bien dans ce mot, plus rigide, contrôlé
que dans celui de massage.
Nous savons que dans pape, patrie,
patriarche, pater il y a papa et je ne peux m'empêcher
ici de trouver dans la syllabe ma de massage celle que l'on emploi pour maman.
Le 'ma'ssage est 'ma'ternant. Mass en arabe c'est le toucher, la palpation mais surtout le toucher.
Les arabes semblent avoir compris avant nous que
le massage n'est pas qu'une question brutale de
friction, ce serait trop court de le limiter
à la seul réponse d'un mal alors que l'on pouvait probablement
faire bien plus long par le toucher pour répondre à un bien.
La friction implique le rythme, l'urgence, la sauvegarde,
on ne peut inscrire la friction dans la durée et se laisser frictionner
plusieurs heures.
Des millénaires de frictions
historiques, politiques et comme si les Lumières
 du
18e siècles et les prémices de la Révolution
industrielle et de ses promesses de vie meilleures devaient
aller de paire avec des corps définitivement
libérés de leurs chaînes, le mot
massage nous arrive par navire. du
18e siècles et les prémices de la Révolution
industrielle et de ses promesses de vie meilleures devaient
aller de paire avec des corps définitivement
libérés de leurs chaînes, le mot
massage nous arrive par navire.
Ces navires
de chêne, gigantesques, majestueux, étaient
eux-même fait aussi de chaînes, bien plus
froides celles-là, mortes-chaînes-de-fer
pour esclaves, pour bien des hommes et des femmes parfois
encore enfants mais ici, dans ce navire de retour des
Indes qu'empruntera Abraham-Hyacinthe
Anquetil Duperron  1731-1805, dans ses notes, celles qu'il s'agirait d'aller
rechercher dans les archives de la Bibliothèque
Nationale de France, se trouve le mot MASSAGE
manuscrit.
Car, avant même d'avoir était publié
pour la première fois dans un ouvrage de langue
française dans ces fameux Zend-Avesta,
tome 1er sur les trois
1731-1805, dans ses notes, celles qu'il s'agirait d'aller
rechercher dans les archives de la Bibliothèque
Nationale de France, se trouve le mot MASSAGE
manuscrit.
Car, avant même d'avoir était publié
pour la première fois dans un ouvrage de langue
française dans ces fameux Zend-Avesta,
tome 1er sur les trois  que
compte la publication éditée en 1771,
un français "l'entend" bien avant cette
date, peut-être dans cette ville de Surate,
en tout cas c'est de là qu'il en parle, il le
note, mieux encore, il se fait masser
par un masseur
Parse
venu le soigner. La transition, l'articulation entre
le terme primitif et son successeur est là, Louis
XVI est encore Roi de France, et dans les malles d'Anquetil,
le roi des mots, celui que rien ni personne ne viendra
désormais détrôner. Anquetil
Duperron ECRIT le MOT "MASSAGE"
pour la première fois, après l'avoir entendu,
, après l'avoir prononcé, il l'écrit
et il l'emmène avec lui et le révèle
à l'occident. Il parle aussi du "mâssé"
mais le masseur, la masseuse reste un
Parse.
Il est à deux doigts, dans un seul texte, au
sain du même livre, de nous restituer la collection
complète des mots qui nous désignent mais
voilà, il désigne le métier, ses
bénéficiaires mais oublie de citer ses
praticiens.
L'erreur sera rattrapée avec beaucoup de maestria
8 ans plus tard par Guillaume
J. H. J. B. Le Gentil de la Galaisière
avec Voyage dans les Mers de l'INDE,
Ed. Imprimerie Royale de 1779 - 1781 que
compte la publication éditée en 1771,
un français "l'entend" bien avant cette
date, peut-être dans cette ville de Surate,
en tout cas c'est de là qu'il en parle, il le
note, mieux encore, il se fait masser
par un masseur
Parse
venu le soigner. La transition, l'articulation entre
le terme primitif et son successeur est là, Louis
XVI est encore Roi de France, et dans les malles d'Anquetil,
le roi des mots, celui que rien ni personne ne viendra
désormais détrôner. Anquetil
Duperron ECRIT le MOT "MASSAGE"
pour la première fois, après l'avoir entendu,
, après l'avoir prononcé, il l'écrit
et il l'emmène avec lui et le révèle
à l'occident. Il parle aussi du "mâssé"
mais le masseur, la masseuse reste un
Parse.
Il est à deux doigts, dans un seul texte, au
sain du même livre, de nous restituer la collection
complète des mots qui nous désignent mais
voilà, il désigne le métier, ses
bénéficiaires mais oublie de citer ses
praticiens.
L'erreur sera rattrapée avec beaucoup de maestria
8 ans plus tard par Guillaume
J. H. J. B. Le Gentil de la Galaisière
avec Voyage dans les Mers de l'INDE,
Ed. Imprimerie Royale de 1779 - 1781 en 2 tomes. en 2 tomes.
Alain
Cabello
jeudi 11 avril 2013 |